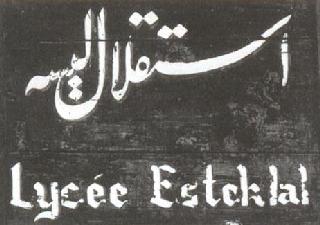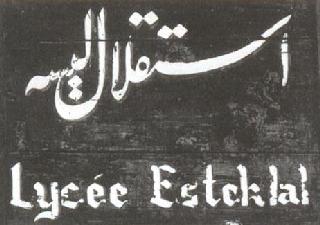|
Esteqlal
"Indépendance"
Au début du XXème siècle, l'Afghanistan entre dans le courant moderniste qui traverse alors tout le monde arabo-musulman. Mahmoud tarzi, en exil depuis 1880 à Damas et Istanbul, rejoint Kaboul en 1904 où il développe ces idées nouvelles. En 1904, le roi Habibullah (1901-1919) crée l'école Habibia: des maîtres musulmans, indiens et turcs ottomans, enseignent des disciplines scientifiques et des langues étrangères. C'est le début d'un enseignement de type occidental. La première école militaire et l'école normale d'instituteurs ouvrent en 1914.
En 1922, le roi Amanullah, à l'instigation de Mahmoud Tarzi, devenu son ministre des Affaires Etrangères, confie à la France la direction pédagogique d'un établissement pilote, l'école Amaniya, où le français est utilisé comme langue véhiculaire pour l'apprentissage des disciplines scientifiques. L'horaire hebdomadaire est de 27 périodes en été, et de 24 en hiver. En section terminale, dite de Mathématiques, tous les cours sont donnés en français. On distingue les cycles suivants:
- Primaire (Heptedaïn) qui dure cinq ans
- Secondaire premier cycle (Ruchdieh) qui dure quatre ans
- Secondaire second cycle (Adadi) qui dure trois ans
L'enseignement est gratuit, ainsi que les fournitures. Le fonctionnement et l'entretien sont entièrement assurés aux frais du gouvernement afghan qui rémunère également les professeurs français, et finance leur voyage et leur logement.
En 1931, l'établissement prend le nom d'Esteqlal. Lors de la visite de Zaher Shah en France en 1965, le projet de reconstruction est évoqué officiellement, car les bâtiments construits par les afghans en 1922 (à leurs frais) donnent des signes de vétusté.
Le Lycée Esteqlal est entièrement restauré en 1968 grâce au soutien du gouvernement français : c’est le Premier Ministre Georges Pompidou, en voyage à Kaboul, qui pose la première pierre du bâtiment moderne.
Ces bâtiments comprennent un centre culturel français, des lieux de réunion, de conférence, de spectacle, un auditorium, des locaux pour l'apprentissage audio-visuel du français, des laboratoires de chimie, physique et biologie, une bibliothèque, des terrains de sport et une piscine chauffée.
Les nouveaux locaux, conçus avec des patios fleuris et des arcades très modernes, sont situés à proximité de l'Arg (le palais royal) dans le quartier des ministères et des ambassades. Ils sont étudiés pour résister aux tremblements de terre.
Le lycée est terminé en 1973 et inauguré en 1974. A cette date, l'établissement compte 2 383 élèves et 31 professeurs français. A partir de 1985, durant le régime communiste afghan, les relations franco-afghanes sont suspendues.
Puis, à l'époque des Talibans, le lycée est en partie détruit: il n'y a plus de meubles, les matières sont changées, il n'y a plus de professeurs français. Les Français sont partis en 1985 et les professeurs afghans du lycée ont quitté le pays pour rejoindre le Pakistan, l'Iran, les Etats-Unis et d'autres pays étrangers.
Après la fin du régime des Talibans, la reconstruction commence en janvier 2002. Elle a dure trois mois. Le lycée a de nouveau ouvert ses portes le 22 mars 2002, le premier jour de l'année Afghane. Après dix-sept ans, le symbole de l'amitié franco-afghane est ainsi réapparu.
Aujourd’hui, le lycée dispose d’une salle informatique, d’un service internet et d’une bibliothèque comportant des livres modernes et de nouvelles méthodes de langue française.
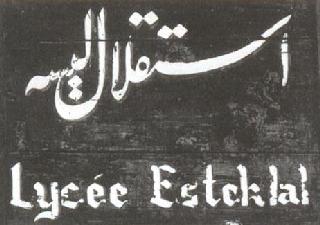











Malalaï
Malalaï est une héroïne légendaire pachtoune de la dernière guerre anglo-afghane. Elle est censée avoir encouragé ses compatriotes lors de la bataille de Maïwand, près de Kandahar, en juillet 1880. Des poèmes en pashto l'ont immortalisée. François Balsan dans son livre "Au Registan inexploré" (Berger-Levrault 1972) la surnomme "la petite Jeanne d'Arc".
Le lycée de filles Malalaï trouve son origine lointaine dans la politique moderniste du roi Amanullah. Mais ce n'est qu'en 1942 qu'il ouvrira réellement ses portes dans son emplacement actuel.
Au début du siècle dernier, alors que l'instruction des garçons est déjà organisée et publique, celle des filles est encore très limitée et privée. Il n'est pas question pour elles d'aller chercher un savoir hors de la maison. Durant le règne d'Amanullah, les efforts du gouvernement consacrés au développement de l'instruction et de la formation professionnelle furent sans précédent. Mais l'émir progressiste et novateur voulait aller plus loin. Il désirait offrir aux fillettes la possibilité de s'instruire. Déjà, en 1914, encore prince, il avait émis le souhait que les sommes importantes prévues à l'occasion de son mariage soient consacrées à la création d'une école ou d'un hôpital réservé aux femmes. En février 1919, quand il succède à son père Habibullah, la création d'écoles de filles devient une de ses priorités. En janvier 1921, une école de filles ouvre à Kaboul, dirigée par des dames de la famille royale. Cette école doit sa création à l'influence et à l'initiative de la famille de la reine, famille de lettrés. En effet, en 1913, Amanullah a épousé Soraya, troisième fille de Mahmoud Tarzi, ministre des Affaires Etrangères. C'est à leur mère, Asma Rasmiya, que la reine et ses soeurs doivent leur instruction. Femme instruite, originaire de l'empire Ottoman où Mahmoud Tarzi a vécu en exil, elle a remplacé auprès de ses filles, une école qui n'existait pas encore à Kaboul. Cette école portera le nom de "Mastourat", qui signifie "voilées, cachées". Soraya a le titre d'inspectrice, sa mère et sa soeur étant respectivement directrice et sous-directrice. De la part de ces femmes courageuses, c'est une manière discrète mais habile de mettre en lumière leurs semblables, absentes de la vie publique.
L'école occupe une maison privée de dimensions modestes, située dans un quartier de la rive gauche du fleuve Kaboul. Elle accueille une cinquantaine d'élèves répartie en deux classes. Elle compte bientôt cinq classes et doit déménager dans une maison plus grande, au coeur de la capitale. A Mastourat, des professeurs hommes apparaissent à côté des dames pour enseigner le persan, mais aussi l'histoire, la couture, la musique, la géographie et les mathématiques. Parallèlement, un hôpital pour femmes, portant aussi le nom de Mastourat, ouvre en janvier 1924. Une soeur de l'émir en est la directrice. Durant cette même année, sous la pression des religieux, l'école et l'hôpital doivent fermer. Quelques mois plus tard, l'école reprend son enseignement mais dans l'enceinte du palais royal, les écoles privées étant tolérées par le gouvernement. En 1926, elle compte 300 élèves dans les classes primaires mais déjà 12 au niveau secondaire. En 1928, sept écoles de filles fonctionnent dans la capitale, mais Mastourat avec 800 élèves reste la "grande école".
En septembre de la même année, quinze jeune filles partent en Turquie, leurs études à l'étranger les préparant à l'enseignement et à la médecine. Toute cette activité éducative cesse durant le voyage des souverains en 1928, puis définitivement en 1929 avec l'abdication du souverain. La famille royale quitte son pays pour un exil à Rome.
En 1932 commence une nouvelle étape dans l'émancipation des femmes. Le gouvernement du nouveau roi Nader Chah favorise, dans l'enceinte de l'hôpital Mastourat, la réouverture de l'école, destinée officiellement à former des infirmières et des sages-femmes. Discrètement on y adjoint quelques fillettes pour leur apprendre le persan et la religion. En réalité, les matières enseignées sont plus nombreuses.En 1938, le ministère de l'instruction publique charge une enseignante française, Madame Fraissé, d'élaborer un projet d'établissement scolaire pour jeunes filles, bien structuré. En septembre 1939, le lycée de jeunes filles ouvre dans l'ancien hôpital Mastourat en attendant que les nouveaux bâtiments destinés à abriter l'école soient construits, et Mme Fraissé en est la directrice. Elle est secondée par une vingtaine d'enseignantes, 11 Afghanes et 9 Européennes, épouses de coopérants étrangers. Les élèves sont répartis en 3 sections:
- la section enfantine, 200 inscrites
- la section primaire, comprenant 4 niveaux, consacrée aux élèves désireuses de poursuivre des études secondaires: 370 inscrits de 8 à 15 ans
- la section réservée à l'enseignement ménager, pour des études plus courtes: 40 inscrits
L'enseignement du français débute dès la première année du primaire à raison de 7 heures hebdomadaires. Toutes les dépenses d'alors (matériel venant de France, salaires, entretien) sont à la charge du gouvernement afghan.
En 1942, l'école emménage dans des bâtiments neufs et prend le nom de Malalaï. Peu à peu, les Afghans rejoignent leur pays après des études en Europe, certains avec des épouses étrangères. Malalaï ouvre alors une section d'allemand et une section d'anglais, la section d'allemand fermant après la fin de la seconde guerre mondiale. Très vite, la plupart des matières sont enseignées en français par des professeurs diplômés recrutés en France. En 1945, les quatre premières bachelières sont diplômées, puis 16 en 1946, et 19 en 1949.
Les bachelières désirant poursuivre leurs études, mais ne pouvant intégrer l'université, alors ouverte exclusivement aux garçons, les professeurs d'université se déplacent donc à Malalaï l'après-midi (car les cours du lycée n'avaient lieu que le matin). Au cours des années, les effectifs augmentent, et les professeurs sont recrutés et formés en Afghanistan. Le français devient la seule langue étrangère enseignée, la direction et tous les cours sont assurés par des afghans, mis à part les cours de langue. En 1968, le lycée accueille la première professeur de français Afghane, suivie de trois autres l'année suivante. Petit à petit, la majorité du corps professoral sera composée d'enseignantes afghanes, des professeurs français assurant toujours jusqu'à aujourd'hui une partie des cours de français.
|